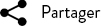"vue aérienne du site du CEREEP- Ecotron IDF, où sont également installés l’Advanced Mobile Lab, Le filtering van et le sampling processing laboratory." Copyright: Nikolaus Leisch/EMBL
Après deux années à sillonner les côtes européennes, de la Norvège à la Grèce, avec plus de 70 000 échantillons collectés sur 115 transects Terre-Mer, les laboratoires mobiles de l’EMBL explorent désormais les écosystèmes d’eau douce.
« Il s’agit de la seconde phase du programme TREC – Traversing Ecosystem que nous avons initiée en septembre dernier avec les équipes du CEREEP – Ecotron IDF [CNRS – ENS PSL] sur le site de Saint-Pierre lès-Neumours », souligne Niko LEISCH, responsable des laboratoires mobiles de l’EMBL. Objectif : comprendre comment rivières, lacs et zones humides réagissent aux pressions humaines et climatiques.
Transposer les protocoles marins à l’eau douce
Avant de déployer son équipe et ses méthodes le long des fleuves, rivières et lacs de toute l’Europe, l’EMBL a dû adapter ses protocoles, initialement développés pour les environnements marins. « La première expédition du programme TREC, lancée par l’EMBL en mai 2023, avec le consortium Tara Océan et l’EMBRC – sous le nom de TRaversing European Coastlines – a en effet parcouru les rivages européens pour prélever et analyser eau, sédiments, sols et air », rappelle Thomas HAIZE, ingénieur d’expédition scientifique.
En étendant son initiative vers l’intérieur des terres, l’EMBL se concentre aujourd’hui sur les écosystèmes d’eau douce, l’interface terre – eau et les milieux terrestres associés. « Le site du CEREEP – Ecotron IDF qui réunit sur plus de 30 hectares une diversité impressionnante d’équipements – chambres climatiques, simulateurs de pluie et de flux gazeux, lacs artificiels, écotrons capables de reproduire jusqu’à 90 % des climats terrestres…- nous a offert un lieu d’expérimentation idéal pour ajuster nos méthodologies aux milieux continentaux », ajoute Antonella RUGGIERO, scientifique du projet TREC.
Une logistique scientifique de précision
Pendant plus d’un mois, l’EMBL a ainsi déployé sur le site du CEREEP – Ecotron IDF ses trois laboratoires mobiles. L’idée est simple : réduire la distance — spatiale et temporelle — entre le terrain et l’expérimentation afin de briser le biais entre prélèvement et analyse.
– L’Advanced Mobile Lab (AML), une remorque-laboratoire équipée de deux extensions latérales, pour une surface totale de 45 m² dédiés à la préparation, l’analyse et la conservation des échantillons. Parmi les technologies embarquées : la microscopie, des solutions optiques standards à la cytométrie en flux, la génomique et le génotypage ou encore la cryomicroscopie à haute résolution, appliquée aux échantillons biologiques en amont de la microscopie électronique. « En seulement 20 millisecondes, les échantillons sont vitrifiés à –196°C », précise Niko LEISCH. L’ensemble est complété de nombreux incubateurs, d’un système de climatisation et d’extraction d’air ultra performant, ainsi que d’une connexion par satellite.
– Le Filtering Van, unité mobile tout-terrain, qui assure la filtration, la concentration et la cryoconservation des échantillons d’eau à proximité immédiate des sites, évitant ainsi toute dégradation des ADN prélevés. Elle dispose, outre son module de filtration, d’un dry shipper et d’un congélateur électrique à très basse température (-20°C).
– Le Sampling Processing Laboratory, camionnette dédiée au stockage des échantillons ainsi qu’au traitement et à la centralisation des données via des tablettes connectées. Digitalisation totale, emballages réutilisables, limitation des transports d’échantillons et traitement local des données… l’empreinte carbone est une préoccupation constante de l’EMBL. « Chaque dispositif est pensé pour être à la fois performant et durable », confie Thomas HAIZE.
De la Seine aux lacs expérimentaux : les premiers tests
Les équipes TREC de l’EMBL ont ainsi réalisé leurs premiers échantillonnages en eau douce et adapté leurs méthodes dans la Seine, les lacs du Gâtinais et les bassins expérimentaux du CEREEP – Ecotron IDF. « Filtrer de l’eau salée ou de l’eau douce n’impose pas les mêmes contraintes : la quantité de matière organique, la taille des particules, la viscosité… tout change. Il faut repenser les protocoles pour garantir la comparabilité des données », précise Antonella RUGGIERO.
Chaque échantillon est traité sur place pour éviter toute dégradation, tandis que des capteurs flottants mesurent simultanément photosynthèse, oxygène, salinité et autres paramètres biogéochimiques. Ces données rejoindront une base environnementale européenne répondant aux principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), afin de fournir des références standardisées pour l’ensemble du réseau TREC.
Prochaine étape : le déploiement à grande échelle sur les fleuves, rivières et lacs alpins, pour comparer les écosystèmes préservés et altérés, et mesurer en conditions réelles l’impact du changement climatique et des activités humaines sur la biodiversité des milieux d’eau douce…
En savoir plus : https://www.embl.org/trec
Source : S. Denis — © La Gazette du Laboratoire